Et si intégrer les femmes dans les instances sécuritaires devenait un acte de paix ? Et si leur présence dans les salles de commandement, les unités de terrain et les commissions permettait de repenser la sécurité comme un bien commun, et non comme une démonstration de la répression ?
Dans les couloirs feutrés des institutions sécuritaires, les voix féminines peinent encore à se faire entendre dans les différents programmes de réformes du secteur de la sécurité. Pourtant, elles sont nombreuses à rêver d’un uniforme, un qui ne les enferme pas dans des rôles subalternes dans lesquels la société les a cloisonné, mais les propulse au cœur des décisions qui façonnent la paix.
Dans les provinces affectées par les conflits dans l’Est du pays, la sécurité ne se mesure plus seulement en nombre de patrouilles ou de postes de contrôle. Elle se vit dans les silences des populations, dans les regards méfiants envers les uniformes, dans les récits d’auto-défense qui remplacent les promesses d’État. Une étude sur l’efficacité des institutions sécuritaires et la perception des parties prenantes révèle une fracture profonde entre les réformes du secteur de la sécurité et leur mise en œuvre réelle.
La Résolution 1325 des Nations Unies, adoptée il y a 25 ans, reste méconnue pour une majorité de Congolaises. Pourtant, elle affirme clairement que les femmes doivent être impliquées dans la prévention des conflits, les négociations de paix et la reconstruction post-crise. Mais sur le terrain, le constat est alarmant : dans les zones comme l’Ituri et le Nord-Kivu, les femmes sont les premières victimes de violences, mais les dernières à être consultées sur les stratégies de sécurité. Au sein des Forces de défense et de sécurité, elles sont souvent cantonnées à des fonctions administratives ou peu valorisantes et rarement promues à des postes de commandement ou de stratégie.
C’est dans ce cadre que Search for Common Ground, a initié, du 3 au 4 novembre 2025, à Kinshasa, un atelier de validation des résultats du diagnostic d’une étude qu’elle a mené sur la gouvernance du secteur de la sécurité et son impact communautaire dans l’Est de la RDC.
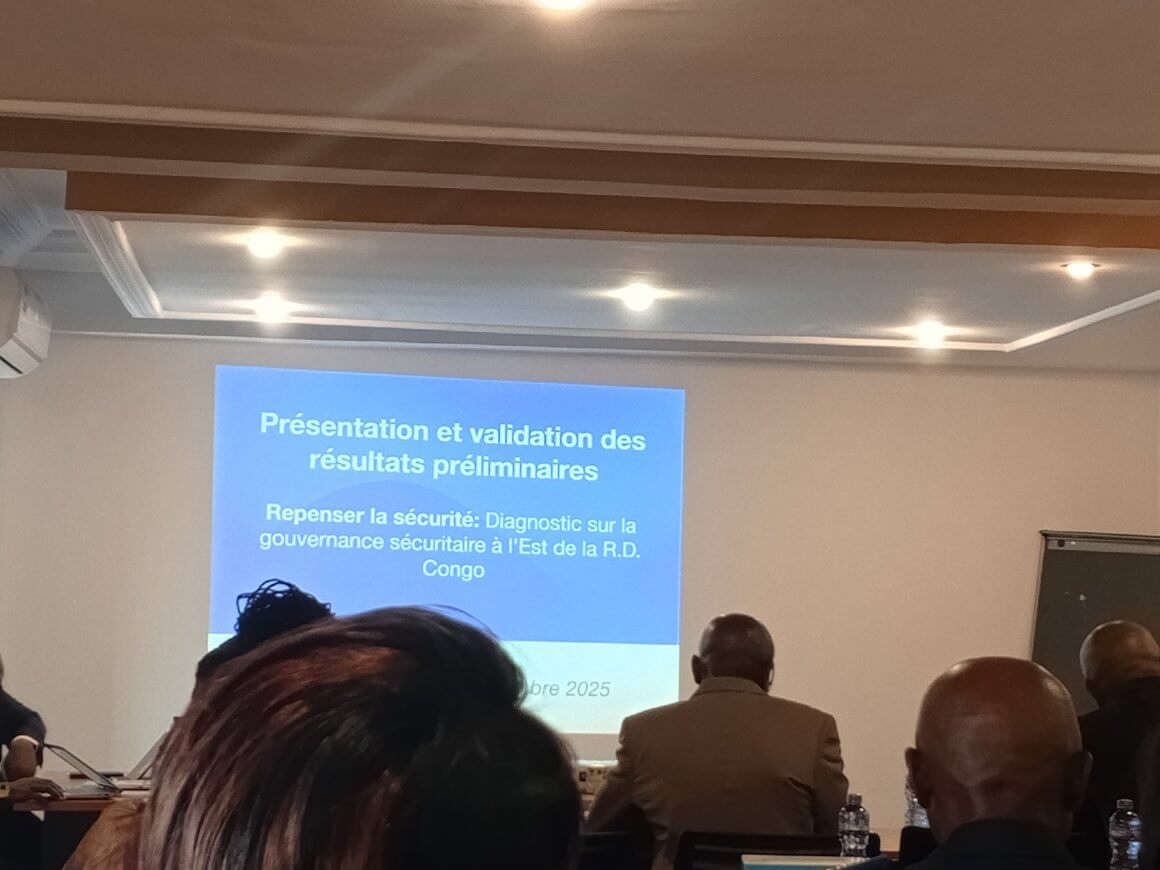
L’objectif : confronter les données collectées depuis juillet 2025 à la réalité du terrain, en présence d’acteurs étatiques, communautaires et internationaux. Les échanges ont permis de croiser les regards, de revisiter les programmes passés et de formuler des recommandations pour une réforme plus inclusive et efficace.
L’inclusion : un mot qui peine encore à se consolider durablement dans la sphère sécuritaire congolaise, où le Genre se recherche encore un siège équitable à la table des enjeux. Ce qui se joue ici, ce n’est pas seulement une question de représentation. C’est une question de justice, de légitimité et d’efficacité.
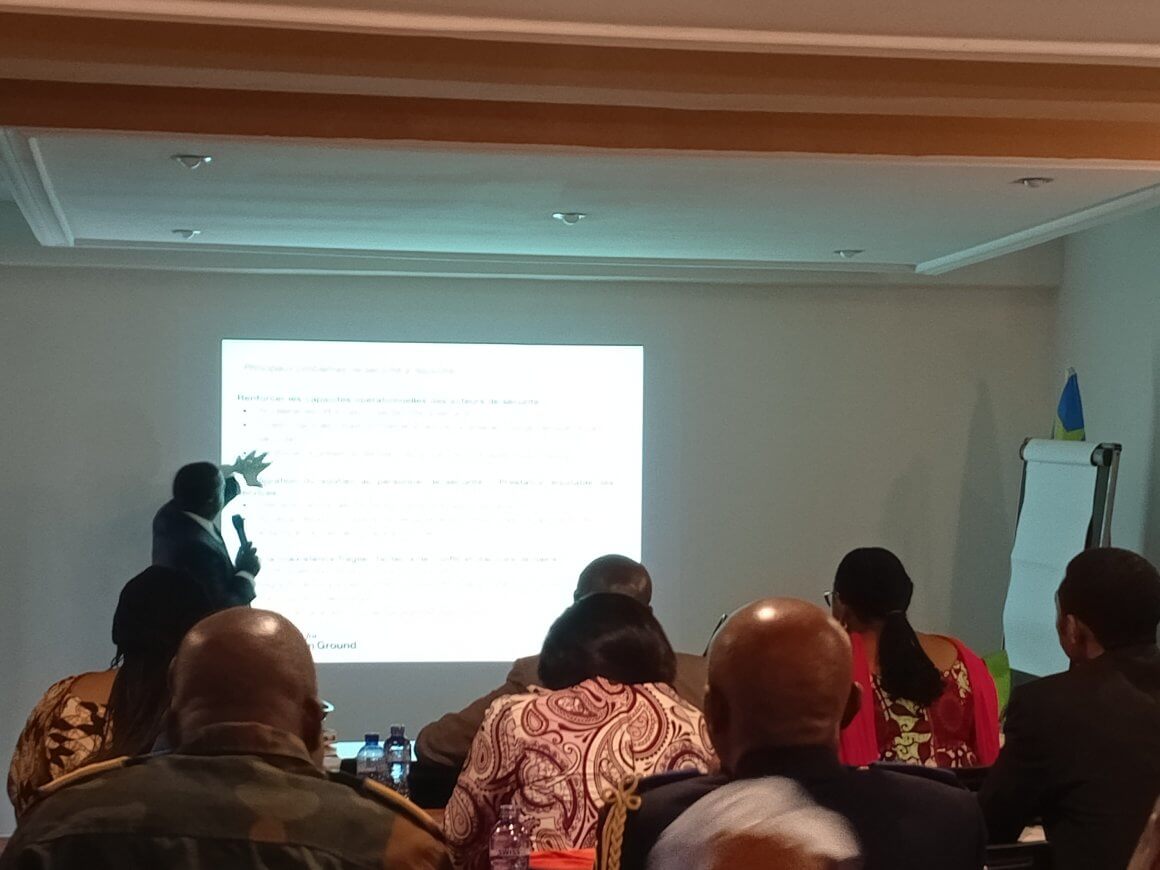
Les femmes apportent une lecture différente des enjeux sécuritaires, souvent plus centrée et mieux adaptée sur la protection des civils, la prévention des violences sexuelles et la reconstruction des liens sociaux. Leur absence dans les sphères de décision prive ainsi la société d’une intelligence collective précieuse pour mieux appréhender les questions sexo-spécifiques avec beaucoup plus d’empathie.
L’affaire de l’adjudante Edjabora, poursuivie pour violation de consignes militaires puis relaxée, a dépeint le reflet d’une société où les femmes dans l’armée sont encore perçues comme des objets de plaisir. Le procès qui s’en est suivi, médiatisé et controversé, a rappelé l’urgence de lutter contre les stéréotypes et de garantir un environnement sécurisé pour les femmes en uniforme.
Parce que chaque uniforme porté par une femme peut devenir un symbole de résilience. Parce que chaque décision prise par une femme dans une instance sécuritaire peut être une graine de paix plantée dans un sol encore trop marqué par les conflits. Parce que raconter leur combat, c’est déjà commencer à le gagner.
Et parce qu’en RDC, la paix ne se décrète pas : elle se construit, une voix féminine à la fois.


